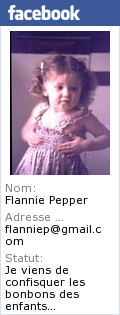MECANISME DE LA FUSION, part 2: Une même quête ?
Depuis ma précédente note sur les hommes et les sacs à main, mon idée se conforte. Il est aussi dur de trouver le sac idéal qu’épouser le prince charmant. J’ai fait cette constatation à la lecture de L’art de la simplicité dans lequel Dominique Loreau cite en 16 points ce que doit être un bon et beau sac. Ces 16 critères essentiels ne sont pas sans rappeler ce qu’on peut attendre d’un homme à mon avis…
Pour elle, le sac idéal doit:
- être aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur (un peu comme Richard Gere depuis qu’il verse dans le bouddhisme),
- être de prix mais d’apparence simple (comme mon homme à moi, nanana…)
- faire office d’objet de décoration et apporter une touche d’élégance sur un canapé ou à vos pieds (à mes pieds, oui, je veux bien ;-))
- faire office d’accessoire de mode, au bras ou sur les genoux (je préfère au bras parce qu’avoir Richard Gere sur mes genoux… pfff)
- être doux au toucher et ne pas écorcher la main (ni la joue, ni la bouche tant qu’à faire !)
- procurer un plaisir secret chaque fois qu’il est utilisé (oui, oh ouiiiiiiiiiiii !)
- se métamorphoser de façon attrayante au fil du temps. Un bon sac devrait durer plusieurs décennies. un sac neuf n’est pas beau. Patience (vous notez les filles ?)
- être assez neutre pour s’harmoniser à toute votre garde-robe (et à toute votre clique de copines)
- être fabriqué dans un cuir souple grâce à des peaux de bêtes élevées dans de bonnes conditions et bien nourries. (demandez lui s’il a été allaité)
- ne pas craindre la pluie (surtout si vous rêvez de l’emmener vivre avec vous en Angleterre)
- avoir une bandouillère ni trop courte ni trop longue (no comment)
- être conçu avec des clous à sa base pour pouvoir être posé au sol sans risque d’être taché (mon homme aurait plutôt besoin d’un bavoir XL)
- être à votre taille afin de flatter votre silhouette. (juste un peu plus grand que moi et plus large ferait donc l’affaire)
- être sans angles durs (qui tuent féminité et douceur) ni formes trop rondes (autrement: régime et pierre ponce pour Albert)
- ne jamais peser, plein, plus de 1.5kg (mettez le au gin plutôt qu’à la bière)
- être agréablement rempli (no comment sinon on va me considérer comme une fille matérialiste et intéressée)
Franchement, vous ne trouvez pas que, entre homme et sac, c’est un peu la même quête ?
Mécanisme de la fusion
Je ne suis pas très sac à main mais il faut bien admettre qu’il y a des moments dans la vie d’une femme où le sac à main s’impose. A une party, par exemple. Ou à un entretien. Ou à une réunion de filles chiquissimes. Difficile de s’y rendre avec un tailleur ou une petite robe d’été et un sac à dos, n’est-ce pas ?
Après un an de poussette fourre-tout, j’ai décidé de m’offrir un sac de fille pour la rentrée, un truc qui encombre les mains, qui glisse tout le temps de l’épaule, qui a une capacité de stockage ridicule… mais qui est diablement féminin.
C’est mon sac, mon petit sac en cuir lilas acheté dans un magasin de dégriff pour trois fois rien. Après l’avoir eu pendu à mon bras pendant toute une matinée, j’ai décidé de l’appeler Lily.
Ben oui, je suis profondément animiste. Je vénère mes tasses à thé, j’embrasse ma voiture, je parle à mes lampes comme à mes lapins… Pourquoi ne donnerais-je pas un nom à mon sac ?
Les it bags du moment portent pour la plupart un prénom: Marcello (qu’est-ce qu’il est beau le Marcello !), Billy, Kelly, Birkin, Raoul… Il parait, d’après la maison Cartier, que c’est pour “souligner le rapport de séduction quasi fusionnel du sac que l’on choisit, qui séduit et qui fait des envieuses.”
Cela explique peut-être pourquoi j’ai eu peu de sacs à main depuis mon adolescence mais beaucoup de sacs à dos. Mes rapports fusionnels n’ont jamais duré plus longtemps que les sacs à 3 centimes vendus à la caisse de mon supermarché.
Je ne suis pas une fille fusionnelle, voilà tout. J’ai quand même cherché à créer une illusion d’intimité avec ce sac.
- Chéri, tu veux bien me passer mon Lily, stiouplé ?
- Ton quoi ?
- Ben mon sac…
- T’as vu mon chéquier ?
- Oui, il est dans la poche intérieure de mon Lily.
- et le gel 1eres dents ?
- Mais dans mon Lily, voyons !
Franchement, ça ne marche pas. La fusion ne s’est pas encore produite entre mon bout de cuir et moi. Lily ne reste pour moi qu’un sac, un joli sac de fille - mon joli sac de fille, certes, mais un sac quand même.
Peut-être que je m’empêche tout simplement d’avoir une relation intime avec mon sac à main parce que je lui ai donné un prénom de fille.
J’aurais dû faire comme Jérome Dreyfuss et l’affubler d’un prénom de footballeur.
Non
Si j’avais dû tomber raide dingue d’un sac, il aurait fallu l’appeler “Sean” ou “Elliot”, des prénoms qui me font vraiment frémir.
Le Sean aurait été coupé dans un beau cuir marron digne d’une fauteuil de gentlemen’s club avec une glissière rouge pour l’insolence et une fine anse rigide pour l’élégance. L’Elliot aurait plutôt été un large cabas taillé dans la peau d’un méchant dragon terrassé par le plus valeureux de tous les chevaliers, Sean le preux cuirassé en personne.
Comme je n’ai pas un smic à mettre dans un sac, aussi beau et luxueux soit-il, je me console en me disant que, à défaut, j’ai un homme, un vrai. Pas aussi fin qu’un Sean (prononcez “chone”, please, pas “chine”) mais c’est un modèle tellement unique que je ne l’échangerai pour rien au monde.
Mon homme, c’est un peu une besace, à mi-chemin entre la besace de l’étudiant et celle de l’ouvrier. Le grain de son cuir est magnifique, un peu vieilli par endroit mais ça lui donne un charme vintage qui me laisse raide dingue. C’est une belle besace en cuir marron avec une doublure en velours côtelé - solide la doublure, très solide, comme la bandoulière d’ailleurs - ni fine, ni large mais incroyablement solide et un peu râpeuse sur la peau nue. Il porte deux grandes poches devant fermées par glissière et une grande poche intérieure dans laquelle s’ébrouent gaiement petites pièces et miettes de biscuit. Dans la partie centrale, on trouve des tas de magazines d’informatique et la revue technique d’une vieille 4L. En fouillant bien, on parvient à en extirper aussi quelques tomes d’une quelconque décalogie de SF et une pierre d’alun.
C’est un sac pratique - pas un mari qu’on trimballe dans les soirées pour porter notre boîte de tampon - c’est un sac pour la vie, solide, large, beau et assez souple.
Et votre homme à vous, quel genre de sac est-il ?
Essence: et la gagnante est…
Youhou ! J’espère que vous n’êtes pas toutes déjà parties en vacances car nous venons enfin de départager les concurrentes du concours « olfactif » ! L’affaire n’a pas été mince car vos textes étaient tous émouvants. Aussi, j’ai préférer vous numéroter et glisser des petits papiers dans le chapeau de Miette car il était impossible de départager en fonction de la qualité de vos textes ! Le numéro qui est sorti du petit chapeau de Miette est donc celui de…
…
…
…
…
LEA
!!!
Bravo à toi, Léa !
Ton texte sur l’Italie de tes grands-parents était sublime. Tu vas donc bientôt recevoir un flacon de parfum Essence ainsi qu’un gel douche et lait corporel (Merci, Sarah !). J’espère que, comme Sophie et moi, tu le trouveras à ton goût, lumineux et aérien.
Essence est un parfum fort surprenant, très à l’image de son créateur, Narciso Rodriguez, créateur américain d’origine cubaine, sacré meilleur designer des années 2002 et 2003.
Si vous jetez un œil à sa collection automne-hiver 2009, vous remarquerez qu’il est très versé dans une valeur qui m’est chère, l’intemporel féminin, et c’est exactement comme cela que je définirais Essence : un parfum intemporel et terriblement féminin, sans cliché, qu’on peut porter du matin au soir, du lundi au dimanche.
Essence ne dénote avec aucune tenue ni aucun moment. De la sortie entre copines en ballerines et robe d’été à la ballade dominicale en short et chaussures de rando, c’est un parfum discret mais présent avec lequel on se sent en confiance, femme, naturelle.
(Cliquez sur les photos pour les agrandir)
De son approche, Narciso Rodriguez dit qu’elle est « classique, mais toujours avec le souci d’inventer du neuf, soit par la coupe, le tissu, une technologie ou encore par un détail d’exécution. Cela permet au vêtement de s’inscrire dans la vraie vie, d’être porté dix ans. » Il veut faire une mode universelle, épousant les courbes de toutes les femmes.
Après le succès de « For her », Narciso Rodriguez a décidé de créer Essence, mélange d’élégance et de pureté basé sur la sensualité du musc et la transformer pour retranscrire l’émotion de la lumière du soleil sur la peau.
Pari réussi ?
Oui, grâce à deux hommes que j’ai eu la chance d’interviewer, Alberto Morillas, le nez et Ross Lovegrove, l’homme derrière le flacon. Je vous les présenterai à la rentrée dans une nouvelle version de l’escarpin et un dossier spécial parfums.
Passez un bel été, mes petits chaussons !
Une nouvelle venue sur l’escarpin: La saga de l’été
Je m’appelle Jane Daktari. Pour beaucoup d’entre vous, mon nom n’évoque rien, tout au plus une allusion à une série américaine des années 70 mettant en scène une espiègle guenon. Pourtant, si ce nom ne vous évoque rien aujourd’hui, il était sur toutes les lèvres - ou presque - dans les années 80.
A l’époque, on me voyait partout : sur les podiums des grands créateurs, les couvertures des magazines les plus branchés, les toits des gratte-ciels de Manhattan, les sommets des volcans en éruption. Je n’avais peur de rien. J’étais partout, de Londres à Timbuktu, en passant par les incroyables Citées d’Or et le Groenland, maniant avec la même prodigieuse dextérité le sabre laser, le lasso, la guitare électrique et le filet à papillons.
J’ai arrêté tant de malfrats et sauvé tant de fois le monde qu’on a écrit plus d’une cinquantaine de livres à mon sujet. Combien se sont approchés de la réalité ? Très peu. On a dit, par exemple, que Clint en avait eu assez de mes frasques mais c’est faux. C’est moi qui l’ai quitté pour le sourire ravageur de Bob (NDLR Redford) parce que j’en avais marre de son manque de romantisme. On m’a prêtée tant d’amants qu’un bottin ne servirait pas à les contenir tous mais comment aurais-je pu courir le monde et les hommes en même temps du matin au soir ? On a écrit d’autres inepties telle que ma supposée allergie au lycra qui me forçait à porter des culottes et collants en 100% coton, ce qui aurait considérablement réduit ma vitesse de vol. C’est encore faux et archi-faux. C’est moi, figurez-vous, qui est mis le lycra à la mode chez les super-héros. J’ai d’ailleurs été la première super-héroïne mondialement connue à adopter les collants en lycra fluo (avec jambières assorties pour les vols de nuit…)
Quant à mes relations avec les autres héroïnes de l’époque, on les a qualifiées de houleuses, voire volcaniques de par mon caractère sans que je puisse me justifier. N’en déplaisent aux mauvaises langues, j’avais des amies dans le milieu : Storm, Supergirl, les sœurs Cats’Eyes… Ensemble, nous formions une sacrée bande !
Et puis, j’ai fait beaucoup de bénévolat, ce qu’on ne dit jamais à mon propos. J’ai créé le premier réseau de communication international d’urgence entre hommes et animaux grâce aux facultés de mon père, le Dr Dolittle. J’ai enseigné l’art du combat au Tibet, la danse classique au Kenya et la musique chez les inuits quand le monde n’était pas à sauver. Je me demande bien pourquoi personne n’en parle jamais. Dans les années 90, vers la fin de ma carrière, j’ai également formé quelques jeunettes. Sans moi, d’ailleurs, Lara Croft serait encore en train de lire Raison et Sentiment dans son vieux domaine d’Abbington…
Mais où en étais-je ?
Ah oui !
…
Je suis Jane Daktari, super-héroïne aujourd’hui reconvertie en mère au foyer. Je ne défraie plus la chronique mais apprécie encore de temps à autre un petit voyage supersonique quand mes enfants ne me laissent pas sur les rotules. J’ai quelques dizaines de kilos de trop selon ma balance espion et n’utilises mes super-pouvoirs qu’en cas de force majeur, quand les enfants sont très en retard à l’école, par exemple.
Je pensais finir mes jours ainsi mais le destin - et un appel téléphonique longue distance - en ont décidé autrement…
(suite au prochain épisode)
De l’élégance des petites choses et des grands êtres…
C’est en relisant les premiers chapitres de L’élégance du hérisson que j’ai réalisé ne pas avoir encore pris le temps d’aller déjeuner au parc de quelques pétales de roses et d’une tasse de shiso…
« Je sers le thé et nous le dégustons en silence. Nous ne l’avons jamais pris ensemble le matin et cette brisure dans le protocole de notre rituel a une étrange saveur.
- C’est agréable, murmure Manuela.
Oui, c’est agréable car nous jouissons d’une double offrande, celle de voir consacrée par cette rupture dans l’ordre des choses l’immuabilité d’un rituel que nous avons façonné ensemble pour que, d’après-midi en après-midi, il s’enkyste dans la réalité au point de lui donner sens et consistance et qui, d’être ce matin transgressé, prend soudain toute sa force - mais nous goûtons aussi comme nous l’eussions fait d’un nectar précieux le don merveilleux de cette matinée incongrue où les gestes machinaux prennent un nouvel essor, où humer, boire, reposer, servir encore, siroter revient à vivre une nouvelle naissance. (…)
Alors, buvons une tasse de thé.
Comme Kakuzo Okakura, l’auteur du Livre du Thé, qui se désolait de la révolte des tribus mongoles au XIIIe siècle non parce qu’elle avait entraîné mort et désolation mais parce qu’elle avait détruit, parmi les fruits de la culture Song, le plus précieux d’entre eux, l’art du thé, je sais qu’il n’est pas un breuvage mineur. Lorsqu’il devient rituel, il constitue le cœur de l’aptitude à voir de la grandeur dans les petites choses. Où se trouve la beauté ? Dans les grandes choses qui, comme les autres, sont condamnées à mourir, ou bien dans les petites qui, sans prétendre à rien, savent incruster dans l’instant une gemme d’infini ?
Le rituel du thé, cette reproduction précise des mêmes gestes et de la même dégustation, cette accession à des sensations simples, authentiques et raffinées, cette licence donnée à chacun, à peu de frais, de devenir un aristocrate du goût parce que le thé est la boisson des riches comme elle est celle des pauvres, le rituel du thé, donc, a cette vertu extraordinaire d’introduire dans l’absurdité de nos vies une brèche d’harmonie sereine. »
(extrait de L’élégance du hérisson, Muriel Barbery, Folio)
J‘aurais pu vous citer bien d’autres extraits mais c’est sur celui-ci que je me suis arrêtée aujourd’hui. Allez savoir pourquoi… Peut-être parce que je rédige actuellement cet article dans un parc, qu’il est à peine 8h et qu’un souffle de vent vient momentanément nous offrir quelques instants de répit entre deux vagues de chaleur. Allez savoir…
Je ne raconterai pas la fin par respect pour ceux et celles qui n’ont pas encore lu le livre mais je crois comme Sophie (si vous ne voulez rien savoir de l’histoire ne lisez surtout pas la note intitulée « ces petites choses ») qu’on a le droit, tout au moins en nos têtes, de réécrire la fin des histoires qu’on aime particulièrement.
J’ai découvert ce second livre de Muriel Barbery il y a environ deux ans. J’en étais à peine à la moitié qu’une amie me dit ne pas aimer lire car elle n’avait encore jamais rencontré de personnages qui lui parlaient. J’ai fait un bond, sorti le livre du sac et lui ai tendu illico. Bien sûr, vous vous doutez de la suite… je l’ai imaginée moi-même car je n’ai toujours pas revu la couleur de mon exemplaire. Heureusement, Folio a eu l’élégance L’élégance de sortir l’histoire en format poche la semaine dernière et j’ai depuis, avec un bonheur non dissimulé, renoué avec Renée, Manuela, Mr Ozu, Paloma…
Aurais-je réécrit la fin de la même manière si j’avais lu le livre d’une traite la première fois ? Allez savoir… Je me demande d’ailleurs si Mona Achache a elle aussi eu le désir de réécrire la fin du scénario à sa manière… réponse ce soir dans les salles obscures avec « Le hérisson », un film librement inspiré du livre de Muriel Barbery.
Interview de Mona Achache (mise à disposition par Pathé Distribution pour les gentils auteurs comme nous…) :
Comment résumeriez-vous l’histoire du film ?
C’est l’histoire d’une rencontre insolite dans un immeuble parisien bourgeois entre Renée, une concierge discrète, revêche et solitaire, Paloma, une petite fille très intelligente et suicidaire et Kakuro Ozu, un riche et énigmatique monsieur japonais.
Quand et comment avez-vous pris connaissance du livre de Muriel Barbery ?
J’ai découvert le livre dès sa sortie. Quelque temps auparavant, j’avais rencontré la productrice Anne-Dominique toussaint et je lui avais fait lire un scénario que j’avais écrit. elle l’avait trouvé intéressant mais un peu « tristounet » et m’avait dit que lorsque j’aurai une histoire plus rigolote à raconter, elle aimerait bien qu’on travaille ensemble. Comme j’aime beaucoup le principe d’adapter un livre, je suis allée à la FNAC pour regarder les quatrièmes de couvertures. J’ai voulu acheter « l’élégance du hérisson », mais j’y ai renoncé, trop d’attente devant les caisses. le soir même, une amie me parle d’un livre qu’elle vient de terminer : « l’elégance du hérisson » ! elle me le prête. Je le lis et j’appelle Anne-Dominique : « J’ai trouvé une histoire ! ». elle répond : « C’est incroyable, il est sur ma table de nuit ». elle le lit, elle est emballée à son tour, on appelle Gallimard et malgré la présence d’autres réalisateurs intéressés, on a obtenu un rendez-vous avec Muriel Barbery. C’est suite à cette rencontre qu’elle m’a choisie et qu’on a obtenu les droits.
Qu’est ce qui vous a touchée dans cette histoire ?
L’absurdité des préjugés, la magie des rencontres improbables… Cet immeuble m’a fait penser à celui dans lequel j’ai grandi, en plus bourgeois. Petite, j’étais fascinée par la superposition, due au hasard, de vies si différentes. Mais le point de départ a surtout été Paloma et renée. Cette femme bourrue qui se métamorphose en rencontrant l’autre… et cette petite fille renfermée, sombre et pleine de certitudes qui, en rencontrant renée et Kakuro, comprend que la vie est beaucoup plus complexe et surprenante que ce qu’elle croyait. Je me suis complètement identifiée à cette petite fille et à cette concierge.
La rencontre entre Renée et Monsieur Ozu ressemble presque à un conte de fées moderne.
L’histoire a tous les ingrédients d’un conte de fées et j’ai essayé de le tourner dans ce sens. Renée, c’est Cendrillon, Paloma, la petite fée, Kakuro, le prince charmant. l’histoire d’amour entre Kakuro et Renée a quelque chose de joliment désuet. Le cadeau, l’invitation, le baisemain, le restaurant, la promenade dans la rue… lorsque renée reçoit l’écharpe offerte par Kakuro, elle est aussi émue qu’une adolescente avant un premier rendez-vous. Ces trois personnages sont réalistes mais en même temps décalés, intemporels et hors norme. J’ai eu envie de créer autour d’eux un univers qui le soit un peu aussi.
Par exemple ?
J’ai, depuis le début, imaginé un immeuble Art Nouveau. Parce qu’il se dégage de cette architecture quelque chose de romanesque, hors du temps, poétique, mais profondément bourgeois et parisien. J’avais le souhait de faire de cet immeuble un personnage à part entière, cohérent avec la forme que je voulais donner au film. Je voulais éviter l’écueil de la représentation d’une bourgeoisie caricaturale à travers un immeuble haussmannien. Je ne voulais pas d’un luxe clinquant, aux dorures et aux marbres abondants. Je voulais une atmosphère plus énigmatique, plus sombre, plus écrasante et plus décalée. l’histoire devait se concentrer dans l’immeuble, comme dans un immense bocal. tout en situant le film dans un contexte réaliste, j’ai eu envie de glisser dans ce Hérisson un brin d’onirisme, de fantaisie et de poésie.
Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés en écrivant le scénario ?
Certains livres sont plus littéraires que d’autres. « l’elégance du hérisson » l’est énormément. l’enjeu de l’adaptation était donc de rendre cinématographique ce qui était littéraire. Dans le livre, Paloma écrit un journal de bord. Dans le film… elle filme et dessine. Je ne voulais pas user d’une voix-off classique et trop abondante. La caméra de Paloma devait être le support de sa voix. Pour Renée, j’ai privilégié le mutisme du personnage. J’ai voulu sous-entendre sa finesse, plutôt que de la rendre audible. le film (comme le livre), est une alternance permanente entre le point de vue de Paloma et celui de renée. il fallait trouver un bon équilibre, ne pas privilégier un personnage plus que l’autre. Qu’elles existent indépendamment l’une de l’autre et que l’une ne devienne pas le faire valoir de l’autre…
Dans le livre, le journal de Paloma est, en plus, très écrit. Le style est même surprenant chez une petite fille.
C’est pour ça que je voulais qu’elle filme sérieusement. Aujourd’hui, tout le monde peut filmer avec des supports extrêmement divers et farfelus. Je voulais que Paloma ait une caméra ancienne, qu’elle ait l’œil dans la visée, qu’elle fasse le point et qu’elle ne cadre pas au hasard sur un écran de vidéo à distance. C’est une petite fille particulièrement douée. Je voulais qu’on le découvre aussi à travers sa manière de filmer et de dessiner. Que son imaginaire soit visuel.
Dans le livre, le calendrier qu’elle construit tout au long du film existe-t-il ?
Non. l’idée du calendrier, sorte de compte à rebours jusqu’à la date de son anniversaire et donc de son suicide, est venue assez tardivement. Chaque jour, Paloma dessine quelque chose dans une case et, à l’arrivée, cela forme une fresque travaillée où l’on retrouve un peu toutes ses pensées.
Quand vous écriviez le scénario, vous pensiez à Josiane Balasko pour le personnage de Renée ?
Oui, en essayant de me l’interdire par crainte qu’elle ne refuse. Mais j’ai pensé à elle à la première lecture du livre. Parce que j’aime cette comédienne, cette femme et ses engagements. l’idée de travailler sur la découverte d’une féminité perdue, avec une comédienne comme Josiane Balasko, était une perspective qui me plaisait beaucoup.
Comment définiriez-vous le personnage de Renée ?
C’est quelqu’un qui dissimule une sensibilité et une finesse particulières derrière les stéréotypes de sa fonction de concierge. elle se réfugie dans la solitude parce qu’elle a peur du regard et du jugement des autres. renée, c’est une femme qui est en dehors de tout effort d’apparence. A force de se dissimuler et de ne pas être regardée, elle a fini par s’oublier. elle a renoncé à sa féminité et étouffé son côté maternel. Au fur et à mesure du film, grâce aux regards de Paloma et de Kakuro, elle reprendra le goût des autres, et donc celui d’elle-même.
Comment Josiane Balasko a-t-elle réagi en lisant le scénario ?
elle n’avait pas lu le livre. Quand elle a lu le scénario, elle a été très directe et elle en a commenté beaucoup de facettes et pas uniquement autour du personnage de Renée. Je crois que c’est notre rencontre qui l’a déterminée. Pour un premier film d’une réalisatrice aussi jeune, il était normal qu’on fasse connaissance avant qu’elle se décide.
À par l’architecture Art-Nouveau pour l’immeuble, aviez-vous des idées très précises pour le décor ?
Le chef décorateur Yves Brover a compris mon envie de ne pas vraiment situer l’histoire dans le temps. on est en 2009 mais il n’y a pas de téléphone portable, pas d’ordinateur, pas de lien technologique vers l’extérieur de l’immeuble. C’est un huis clos intemporel. Dans la chambre de Paloma, il n’y a pas d’affiche, pas de marque, aucune référence à notre époque, mais seulement des dessins et des objets. Pour autant, je ne voulais pas d’artifices ou d’un univers trop esthétisant. Je souhaitais rester réaliste mais avec une pointe d’onirisme. J’avais une image du film Mary Poppins en tête. Celle des deux enfants qui, pénétrant dans l’immense banque de leur père, semblent écrasés par la lourdeur du conservatisme bourgeois. Aussi abstrait soit-il, le souvenir de cette banque a été un point de départ pour l’atmosphère que je voulais donner à cet immeuble : un réalisme un peu bancal, décalé.
C’est pour cela que vous avez voulu tourner en studio ?
L’immeuble dont je rêvais n’existe pas. et Anne-Dominique toussaint a compris que ce n’était pas un caprice mais que ça allait servir l’histoire. Ainsi, j’ai eu la chance de pouvoir écrire le scénario en imaginant une configuration d’appartement très particulière. C’était très important pour moi que l’appartement d’Ozu soit construit sur le même « moule » que celui de la famille de Paloma, et qu’ils se distinguent par leur ameublement. Pour la famille Josse, j’avais en tête l’appartement d’une famille de gauche accueillante, sympathique, et chaleureuse, avec des parents joyeusement névrosés mais pas immédiatement insupportables. Je voulais éviter de tomber dans le cliché des méchants bourgeois et je ne voulais pas d’un décor glacé.
Et pour la loge de Renée ?
Elle lui ressemble : la pièce principale et sa cuisine sont une sorte de « vitrine » parfaitement impersonnelle du stéréotype de la concierge parisienne. Ni trop, ni pas assez. et dissimulée au fond de sa loge, sa bibliothèque : une pièce chaleureuse, surchargée de livres et de petits objets qui lui sont plus précieux.
Quel est votre meilleur souvenir ?
Le jour où Anne-Dominique m’a appelée un soir de décembre pour me dire : « Joyeux Noël ! C’est nous qui avons les droits du Hérisson ! ». et un an plus tard, quand elle m’a appelée pour me dire : « Joyeux Noël ! Josiane Balasko a lu le scénario et veut te rencontrer ! ». Mais j’en ai beaucoup d’autres… le petit rituel du matin : emmener mes filles à l’école, prendre la voiture en direction d’Epinay avec Patrick et le stagiaire mise en scène en écoutant de la musique ringarde ! L’arrivée au studio, le café, le croissant, puis l’heure de travail que nous prenions quotidiennement avec Patrick, la scripte et l’assistant mise en scène pour préparer la journée de tournage avant l’arrivée des comédiens et du reste de l’équipe. J’ai vécu tous ces moments comme des instants privilégiés. Nous avons tous vécu en vase clos dans les studios d’epinay pendant de nombreux mois. Même la monteuse, Julia Grégory, s’était installée dans un bureau des studios pendant le tournage. Cela a créé une atmosphère très intime au sein de l’équipe qui, d’après-moi, a nourri le film.
Finalement, qui est le hérisson ?
Je crois que nous sommes tous un peu des hérissons dans la vie… avec plus ou moins d’élégance !
Si vous voulez lire les interviews de Josiane Balasko et Togo Igawa, je les mettrais en ligne demain. Ceux et celles qui seront déjà partis crapahuter loin des salles de ciné pourront toujours patienter jusqu’à la sortie du DVD grâce à Folio qui vient de sortir L’élégance du hérisson en format poche (Comment ça, je l’ai déjà dit ?), format fort appréciable pour les vacances et les transports (ainsi que les minuscules tables de chevet…), agrémenté en prime d’une magnifique photo de Stéphane Barbery dont voici l’originale (merci à lui de m’avoir autorisée à la découper pour faire une vignette…)

LE HERISSON
De Mona Achache
Sortie en salle le vendredi 3 juillet
Renée Michel Josiane Balasko
Paloma Josse Garance Le Guillermic
Kakuro ozu Togo Igawa
Solange Josse Anne Brochet
Manuela lopez Ariane Ascaride
Paul Josse Wladimir Yordanoff
Colombe Josse Sarah Le Picard
Jean-Pierre Jean-Luc Porraz
Madame de Broglie Gisèle Casadesus
Madame Meurisse Mona Heftre
tibère Samuel Achache
la Mère de tibère Valérie Karsenti
le Père de tibère Stéphan Wojtowicz
Directeur de production Pascal Ralite
Son Jean-Pierre Duret
Arnaud Rolland
Nicolas Naegelen
Chef monteuse Julia Grégory
Créatrice des costumes Catherine Bouchard
Chef maquilleur Didier Lavergne
Chef coiffeur Cédric Chami
réalisatrice des séquences animées Cécile Rousset
1er ass. mise en scène Fabrice Camoin
Casting Michael Laguens
Sophie Blanvillain
Les recettes de la babouche: gateaux au piment
Nous avons découvert l’île Maurice dans les années 70. L’été français correspond, dans l’hémisphère sud, à l’hiver austral : froid, pluie, ciel bas et gris, je ne vous fais pas un dessin, à vous les françaises qui vivez ça presque 8 mois de l’année… Donc, nous partions à l’Ile Maurice pour deux mois de grandes vacances. Nous descendions dans un « campement » -une maison de bord de mer- au Nord de l’île, un lieu dit « Trou aux Biches ». Murs de pierre volcanique, bougainvillées en cascade, la mer au pied de la maison, avec ses rochers noirs et sa plage blanche de sable corallien. Une mer alanguie, aux allures de lac, qui nous offrait en guise de tribut des monceaux de göémond aux acres relents de marée. Moi qui ne connaissais de la mer que cet océan déchaîné et sauvage de mon pays malgache, je trouvais celui là bien paresseux ! Des olothuries, ces concombres de mer dont sont si friands les chinois, tapissaient le sable de leurs corps mou et visqueux. Je n’aimais pas me baigner dans cette eau-là. Pourtant, quelle beauté, quels spectacles que ces couchers de soleil où nous guettions le rayon vert, quel calme ! Les moineaux seuls venaient troubler ce silence rythmé par les vagues qui venaient lentement mourir sur la berge. Les moineaux, effrontés, qui s’invitaient à notre table, nichaient dans les toits de chaume et commençaient leurs incessantes conversations au lever du jour. Une fois par semaine, une musique se faisait entendre de loin, annonçant la voiture du marchand de glaces. Quand on entendait la mélodie, on se précipitait sur la route pour faire signe au marchand. Il entrait dans le jardin et là commençait la fête. Des glaces de toutes les couleurs, à tous les parfums, sorbets, esquimaux, petits pots, on ne savait plus lesquelles choisir. Alors, ma grand-mère les prenait toutes… A la fin des vacances, plus besoin de courir sur la route faire signe au marchand, il s’arrêtait automatiquement chez nous !
En fin d’après-midi, nous allions à la grande ville voisine, Grand Bay, acheter du poisson à la criée et du ravitaillement à la « boutik chinoi ». Sur la véranda de la boutique, officiait une jeune femme tamoul : brasero ronflant devant elle, bassine d’huile bouillante, elle y jetait des petites boules de pâte qui doraient en quelques minutes : les gâteaux piment. La pâte est à base de pois chiches concassés fin et d’épices, dont du piment langue d’oiseau qu’on appelle à Madagasar « tsy mazaka dimy lahy » -cinq hommes ne le supportent pas- ce qui traduit bien la violence de la chose…C’était merveille de voir cette jeune femme si frêle, dans son sari aux couleurs vives, nous offrir ses gâteaux piment avec un sourire lumineux. Nous mordions dans cette pâte brûlante, nous ébouillantant lèvres et langue, trop gourmands pour attendre. Le parfum de la farine de pois chiches et d’épices nous envahissait le palais. Une fois rassasiés -mais se rassasie-t-on vraiment du goût du bonheur ?- nous éteignions le feu du piment avec une tranche d’ananas frais et juteux.
Grand Bay est devenue une grande ville moderne, de ces villes de bord de mer américain, terrasses en bord de plage, mall proposant aux touristes des milliers de vêtements made in Mauritius. La boutik chinoi n’est plus qu’un souvenir lointain. La marchande de gâteaux piment n’est plus sur la véranda. C’est son fils qui l’a remplacée, un peu plus loin sur la promenade. Le temps a passé, les choses ont changé, la vie a fait son œuvre, mais chaque fois que parvient à mes narines le parfum de ces gâteaux dans leur bain d’huile bouillante, j’ai dix ans et je suis heureuse…
Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 500 g de pois chiches
- 1 cuillère à soupe de cumin
- 1 gros morceau de gingembre
- 1 bouquet de cotomili (coriandre)
- 1 botte de ciboulette
- 10 petits piments verts
- sel huilePréparation :
La veille : mettre les pois à tremper dans beaucoup d’eau.
Le lendemain : enlever les peaux (très facile).
Ecraser les pois au pilon ou à la moulinette (grille moyenne).
Mélanger cumin, gingembre râpé, piment coupés fin et sel. Hacher finement ciboulette et cotomili.
Mélanger soigneusement le tout. Il faut que la pâte soit un peu collante, sinon les gâteaux risquent de se désintégrer dans l’huile.
Faire de petites boulettes très compactes, les aplatir légèrement dans la paume de la main.
Faire chauffer beaucoup d’huile dans une poêle, y faire revenir les bonbons piment jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.NB : On peut très bien ne pas mettre de piment, ou en mettre 10 fois moins…ça n’enlève rien à la saveur des ces amuse gueule.
échantillons d’enfance ou comment amorcer la nouvelle saga de l’escarpin…
A l’approche des vacances, j’ai décidé de vous parler aujourd’hui d’une de mes grandes passions. Une de celles qui n’ont pas pris une ride depuis ma plus tendre enfance et que j’assume pleinement chaque fois que je dois plier bagages. J’ai nommé… la collection d’échantillons.
Je suis une obsédée de l’échantillon à tel point que je pourrais presque forcer les boîtes aux lettres de mes voisins si Nana recommençait son opération de promotion de la serviette ultra-mince à ailettes (je sais, ça date… mais je me souviens avoir fait toute ma montée ainsi que celle d’en face avec la complicité de ma mère pour aller récupérer des échantillons de serviettes hygiéniques dans les boîtes aux lettres de mon très respectable quartier).
En fait, cette maladie remonte à ma petite enfance. A l’époque, j’étais grand reporter ET super-héroïne ET vétérinaire ET rock-star. Ne riez pas, c’était du sérieux. J’étais une sorte de Clark Benatar, fille cachée du docteur Dolittle ( je communiquais parfaitement avec les animaux) et de Diane Fossey. J’avais le sex-appeal de Farah Fawcett et mon costume était surtout moins criard que celui de Wonderwoman. J’avais le look “super amazone” en mission. Bien sûr, quand il s’agissait de faire un simple reportage, je dissimulais mon costume sous des sahariennes écru et des tailleurs hyper cintrés que je repérais dans les catalogues de La Redoute de ma mémé. Pas toujours pratique avec le panier tressé que je passais par-dessus ma tête mais comment voulez-vous trimballer votre gamelle, votre sèche-cheveux et votre sabre laser dans un petit sac à main (et oui, j’avais aussi un sabre laser car mon père, le vénérable Dr Doolittle, avait quelques liens avec la famille Skywalker. Le jour où je l’ai appris, je me suis effondrée car j’étais passionnément amoureuse de Luke…) ?
Je n’avais que le lourd panier de ma grand-mère pour transporter toutes mes affaires. Il était si grand que je passais ma tête sous la anse et le portais autour du cou pendant mes missions. Je voyageais sans cesse d’un pays à l’autre. Je me posais rarement (sauf quand ma grand-mère me hurlait que le repas était prêt…). J’avais toujours une idée de reportage, un mystère à élucider, un pays à explorer… ou à sauver.
Plus les années passaient, plus mon panier devenait lourd. A chaque anniversaire, je rajoutais de nouveaux jouets et je finis par me rendre à l’évidence: un personnage de mon importance ne pouvait courir le monde affublé de la sorte. Vous avez déjà essayé d’échapper à une horde de nomades du désert appartenant à une secte de mangeurs de femmes avec un panier de 10 tonnes autour du cou ? Moi, j’ai failli y rester plus d’une fois. J’ai fini par choisir mes tenues et mon nécessaire de voyage avec plus de soin. Seules mes armes, mon bloc-note, mon faux appareil photo et quelques poupées m’accompagnèrent par la suite dans mes voyages.
C’était la grande époque du Diamant Vert bientôt suivi du Diamant du Nil. Chaque mercredi, chez ma grand-mère, je m’envolais pour la Colombie puis le Moyen-Orient. J’étais fan de Joan Wilder. Je voulais devenir écrivain et si possible aussi sexy qu’elle. Le hic, c’est qu’elle finissait toujours couverte de boue et les cheveux en bataille. Ma grand-mère ne voyait plus mes missions d’un bon oeil. Aussi, pour la rassurer, je me munis d’une trousse de toilette dans laquelle je fourrais tous les produits de beauté et savons que je trouvais dans les tiroirs de ma maman.
J’avais 10 ans. Je devenais plus Joan que Wild. J’occupais maintenant les 3/4 de mes missions à me pomponner. Je me laissais kidnapper plus souvent qu’à mon tour, refusant d’utiliser mes super pouvoirs dans l’espoir fou qu’un ténébreux aventurier volerait chaque fois à mon secours. Et ça marchait. Ca marchait à tel point que mes patrons (comprendre: mon rédacteur en chef et le grand patron des services secrets) finirent par me mettre au placard. Je n’avais plus aucun scoop à fournir et je ne sauvais plus le monde. J’étais juste… amoureuse.
Je finis toutefois par me lasser et mis fin à ma relation avec Jack (=Michael Douglas) au début de l’été suivant. Je n’avais pas encore 11 ans mais je venais de voir Le bon, la brute et le truand. Clint était mon homme. Je fis des pieds et des mains pour que mon rédac chef m’envoie couvrir un sujet brûlant au fin fond du Far West. Alors que je préparais mon panier, ma grand-mère me descendit du grenier un vieux sac à appareil photo. Il avait des poches partout et se fermait par zip. C’était le sac d’aventurier par excellence ! Le seul inconvénient est qu’il n’était pas aussi grand que le panier. Ni mon lion en peluche (qui ne me quittait plus depuis ma première mission dans la savane), ni le sèche-cheveux rentraient dans le sac. C’était fort ennuyeux.
Je me souviens avoir piqué des crises rocambolesques plusieurs après-midi de suite parce que je ne pouvais pas transporter ce que je voulais. Je devenais rouge, tassais, tassais, retirais, retassais, jusqu’à crier, secouer le sac et jeter tout par terre en donnant de grands coups de pieds dans le lit de ma mémé.
Un jour, alors que je rentrais d’un reportage à la Coop du coin, j’ai marché sur quelque chose qui allait changer ma vie: c’était un petit emballage carré contenant un drôle de truc rond et mou. Malgré mes presque 11 ans, je ne savais pas ce que c’était. Mon instinct me disait que ce n’était pas comestible mais c’était à peu près tout. je le mis dans ma sacoche en me disant que ça ressemblait aux échantillons de crème que ma maman trouvait dans les magazines.
J’étais toute excitée: enfin, j’avais trouver le moyen d’emmener mon nécessaire en voyage sans devoir choisir entre le sabre laser ou le shampooing. Il suffisait que je trouve des échantillons de tout !
C’est ce dernier mot qui me causa le plus de problème. A l’époque, tout n’existait pas encore en échantillon. Hormis la capote british que j’avais trouvée dans la rue (je n’ai appris qu’un an plus tard à quoi elle servait réellement…) et deux sachets de crème anti-rides chèrement négociés avec ma maman, je n’avais rien d’autre. En bonne esclavagiste pourrie gâtée que j’étais, j’ordonnais à ma grand-mère de chercher dans tous les magazines qui peuplaient la salle d’attente de son médecin. En vain. Je voulais également la forcer à fouiller chez le buraliste. Et à supplier le pharmacien. Piquer des minis choses au supermarché…
Bien sûr, elle n’en fit rien. A la place, elle m’offrit des savons d’invités Roger & Gallet et une micro boîte de concentré de tomates (pour accommoder les grillons, c’est toujours utile…). Dans mon sac, j’ai rajouté quelques fruits en plastique sortis de mon vieux carton de dinette, un rouge à lèvres de Barbie, mon K-Way et mes lucioles Bonux. J’étais fin prête même si, à mon grand regret, on ne faisait pas encore d’échantillon de pâtes aux oeufs et de dentifrice.
Je n’avais plus qu’à partir à la recherche de Clint…
(suite au prochain épisode. D’ici là, je vous laisse spéculer sur le nom la super-héroïne que j’étais…)